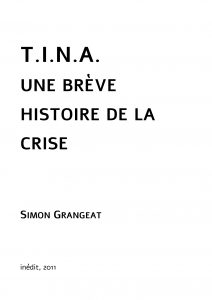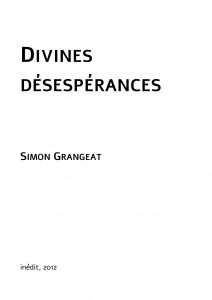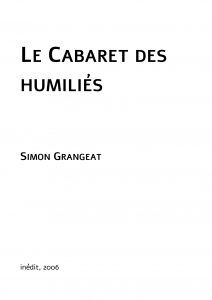Un Cœur Moulinex
inédit, 2016
70 pages
PERSONNAGES :
11 femmes
17 hommes
la pièce peut être jouée à partir de sept interprètes, jusqu’à une distribution chorale
Prix et sélections
sélectionnée par le collectif À mots découverts.
sélectionnée par le bureau des lectures de la Comédie Française
coup de cœur du comité de lecture du Panta Théâtre
sélectionnée par le comité de lecture des EAT
Soutiens à l’écriture
écrite en résidence au conservatoire à Rayonnement départemental et aux Archives municipales d’Alençon (61)
accompagnée par le collectif À mots découverts

En 1932, contraint de manger une purée granuleuse préparée par sa femme, un bricoleur de Bagnolet imagine l’ustensile qui fera sa fortune. Le moulin-légume est né. La Manufacture d’Emboutissage de Bagnolet, rebaptisée Moulinex, devient un empire industriel mondial. Soixante-neuf ans plus tard, le groupe dépose le bilan – les usines sont démantelées, les ouvriers licenciés, les dirigeants quittent le navire en parachutes dorés.
Un cœur Moulinex saisit l’histoire de l’entreprise comme modèle d’une aventure industrielle percutée par la mondialisation et la financiarisation de la fin du vingtième siècle, un cas d’école pour comprendre le mouvement d’industrialisation / désindustrialisation qui agite l’Europe du vingtième siècle.

mise en scène Claude Viala

mis en lecture par Chloé Simoneau

direction Virginie Boucher
extrait
Jean Mantelet. – En 1956, nous occupons cinq cents personnes pour fabriquer nos produits à manivelles.
Marcel Georges. – Ça marche très bien.
Jean Mantelet. – Oui, mais il y a un problème.
Marcel Georges. – La progression est régulière.
Jean Mantelet. – Et il va falloir résoudre ce problème.
Marcel Georges. – Qu’est-ce que vous craignez, monsieur Mantelet ?
Jean Mantelet. – Je pense… Regardez dans la cour, Georges. Qu’est-ce que vous voyez ?
Marcel Georges. – Des vélos-moteur.
Jean Mantelet. – Cela ne vous fait penser à rien ?
Marcel Georges. – Je ne sais pas.
Jean Mantelet. – Est-ce que vous voyez encore des vélos ?
Marcel Georges. – Presque plus, non.
Jean Mantelet. – Les fabricants de vélo à pédale ont perdu presque toute leur place au profit des fabricants de vélo-moteur, Georges.
Marcel Georges. – Ah oui !
Jean Mantelet. – Georges : de même qu’aujourd’hui, plus personne ne veut pédaler, un jour, la femme ne voudra plus tourner la manivelle. Et ce jour-là, c’en sera fini de mon moulin à légumes ! Si nous ne voulons pas disparaître, Georges, il faut absolument trouver une solution.
Marcel Georges. – Et vous avez la solution !
Jean Mantelet. – Patience. Je pense.
– Jean Mantelet cherche une idée.
Jean Mantelet. – Je pense.
– Il pense !
Jean Mantelet. – Oui, mais là, je ne pense à rien ! Laissez-moi, tous !
l’écriture
En 2012, Virginie Boucher, responsable du département théâtre du Conservatoire d’Alençon, me contacte pour animer un atelier d’écriture à destination des élèves de cycle III.
Son intention est de proposer à ses élèves une initiation à l’écriture documentaire à partir des archives municipales retraçant la vie de « l’usine mère » de Moulinex, implantée dans la ville de 1937 à 2001 – date du dépôt de bilan de l’entreprise.
Lors d’une première séance de travail aux archives municipales, je consulte la revue de presse consacrée à l’entreprise et découvre un article de Frédéric Lordon analysant la chute de Moulinex, non comme un fait isolé, mais comme le marqueur des « grands invariants de la désindustrialisation française ».
Outre leur fantastique fonds papier, les archives municipales d’Alençon possèdent cinquante heures d’enregistrement sonore de témoignages d’anciens employés de Moulinex.
Ce matériau allie la puissance émotionnelle des récits de vies entières vouées à l’entreprise, et l’appréhension d’une machinerie supérieure broyant les individus sous des logiques économiques implacables.
C’est de ces matériaux qu’est née l’envie d’écrire Un cœur Moulinex.
De novembre 2012 à juin 2013, j’ai écouté et retranscrit l’intégralité des cinquante heures de témoignage. J’ai pris contact avec les deux associations d’anciens employés de Moulinex. J’ai consulté films, livres, reportages télévisuels ou radiophoniques disponibles sur l’histoire de Moulinex et de sa chute.
Ensuite, je me suis mis à écrire…
Autour de la pièce
Dans la presse

Ah purée, quelle histoire ! La blague est facile, mais inévitable et inusable, elle figure bien sûr dans Un cœur Moulinex qui raconte sur un mode enjoué et souvent comique cette histoire industrielle doublée d’une tragédie ouvrière. Et les anciens de Moulinex doivent aujourd’hui avoir une pensée quelque peu émue et fraternelle pour leurs collègues de Tupperware eux aussi prochainement mis sur le carreau au nom de la sacro-sainte mondialisation, si rien ne bouge.
Puisant à de nombreuses sources documentaires, Simon Grangeat a mis en pièce – faite de saynètes et d’intermèdes publicitaires – l’histoire de cette entreprise qui prend naissance en 1932 ; voit son essor dans les années 60 (introduction en bourse en 1969) ; est leader du petit appareil ménager au début des années 80, employant plus de 10 000 personnes dans douze usines (la plupart en Normandie mais aussi à l’étranger). En 1985, le groupe connaît son premier exercice déficitaire et l’année suivante ses premiers licenciements, année qui voit également le fondateur de l’entreprise, Jean Mantelet, atteint d’une hémiplégie. En 1990, l’endettement est de 350 millions d’euros, le fondateur meurt l’année suivante. La suite est une affaire de rapaces (comme Jean-Paul Naouri, ex-directeur de cabinet de Pierre Beregovoy, aujourd’hui PDG du groupe Casino et président d’honneur et administrateur de l’Institut d’expertise et de prospective de l’École normale supérieure, qui a pour vocation d’être le lien entre l’École normale supérieure et les entreprises) et de prédateurs italiens (les roublards frères Nocivelli) qui s’en sortent bien alors que les ouvriers paient les pots et les vies cassés. En 2001, les cadres de SEB s’installent chez Moulinex. Ces soixante-dix ans sont racontés au pas de charge et donnent à voir en accéléré le passage d’une petite entreprise née du cerveau d’un inventeur de génie, à une grande entreprise dirigée par l’inventeur devenu patron paternaliste (les noms de ses robots, comme Jeannette, sont les prénoms de ses secrétaires), une entreprise leader qui va subir le choc de la crise pétrolière avant d’être dépassée par un monde de la finance et des stock-options qui n’est pas le sien. Purée, quelle belle et triste histoire !
Jean-Pierre Thibaudat
Mediapart
octobre 2017

Nos mères utilisaient le moulin-légume pour leurs soupes et leurs purées. Il n’est pas sûr que certaines personnes ne se servent pas encore de cet ustensile en métal partiellement perforé, doté d’une boule rouge permettant de bien tenir la manivelle. C’est cette histoire – qu’on ne confondra pas avec celle du moulin à café, qu’on calait plus facilement entre les deux jambes – qu’on nous raconte au théâtre ! Ou plutôt l’histoire de son créateur, Jean Mantelet, et de son entreprise d’abord appelée Manufacture d’emboutissage de Bagnolet puis rebaptisée Moulinex : en 1932, l’artisan a l’idée de cet appareil. Après quelques tâtonnements, l’invention marche, séduit le public féminin. C’est un triomphe, le patron saura s’adapter pendant des années, jusqu’à ce que, dans les années 60, il ne comprenne plus l’évolution des mécanismes financiers et se fasse éjecter par de grands méchants loups – lesquels casseront tout mais vendront l’étiquette Moulinex, qui n’a pas disparu.
Simon Grangeat, qui connaît le dossier comme s’il avait eu à le traiter au Tribunal du commerce, rit de cette affaire en nous la contant sur le mode de l’agit-prop, d’un rire jaune. Il y eut d’abord le capitalisme patronal, qui avait ses défauts et des qualités (l’ouvrier n’était pas toujours un numéro) puis le capitalisme des grands groupes (l’individu est dissous dans une recherche du profit féroce et, par dessus le marché, contre-productive ! ). On se passe les rôles, on fait contre mauvaise fortune bon coeur. C’est comme un dessin de presse (mais c’est vrai que les dessins de presse ont à peu près autant disparu que les moulins-légume) : rapide, juste, plaisant, polémique avec vérité. C’est du Dario Fo français. Et cela contribuera à empêcher que cette casse misérable d’un moulin populaire passe à la moulinette de l’Histoire.
Gilles Costaz
WebThéâtre
novembre 2017

L’usine Moulinex d’Argentan a fermé en 1997 et cette représentation a été l’occasion pour une partie des anciennes ouvrières et employées de Moulinex de retrouver leur histoire. Jouer ici est évidemment très particulier. Cela créé un souffle très émouvant lors de la représentation, quelque chose d’empathique qui vibre immédiatement entre la scène et la salle. Je ne peux m’empêcher de penser à cette « re-présentation » chère à Denis Guénoun. Nous présentons de nouveau la salle sur scène et c’est si rare que les conditions soient réunies pour réussir cela ! Après la représentation, des discussions s’engagent, évidemment. Vingt ans plus tard, la fermeture de l’usine reste toujours une plaie béante. Les corps sont marqués, les gens abîmés malgré tous leurs efforts. L’extrême violence sociale qui fait s’arrêter une usine pendant que les financiers se servent dans les caisses arrête le temps. On parle aussi des enfants des Moulinex ; certains d’entre-eux parlent aussi. On parle des enfants des financiers de l’époque… Comme si une histoire qui avait marquée plus d’un demi-siècle de la région pouvait se résorber en rasant des bâtiments. Comme si l’histoire ne se transmettait pas de corps à corps, entre les familles, dans les villes. En écoutant ces anciennes (et quelques anciens) Moulinex, j’entends aussi notre dis-société se dire.
Rémi Mauger et Nicolas Carbard
France 3

Nous sommes dans du théâtre didactique et Simon Grangeat s’inscrit dans la lignée de Brecht. Il y a aussi du Michel Vinaver dans sa manière de traiter les personnages comme les voix de quelque chose de plus grand. Les personnages d’ouvrières ont des prénoms mais elles représentent à elles-seules toutes les autres. Seuls les dirigeants ont des identités et des caractères définis puisqu’ils sont réels. Cependant, Simon Grangeat n’oublie pas qu’un message passe mieux avec un peu de « divertissement ». Le texte n’est ni lourd, ni trop sérieux. Il est souvent drôle et ironique. Il apporte même une dose de nostalgie aux spectateurs qui ont grandi entourés de cet électro-ménager qui a conquis toutes les cuisines.
Florian Vallaud
Culturotopia
novembre 2017

Le texte de Simon Grangeat décortique et met en parallèle un incroyable destin humain (Mantelet est un vrai personnage de théâtre ! ) avec une implacable fresque sociétale. L’auteur nous décrit de façon lumineuse et subtile le paternalisme, la dimension sociale d’un « patron à l’ancienne », la réussite, puis l’aveuglement de ce chef d’entreprise vieillissant face à la mondialisation, et en parallèle, la tyrannie des chefaillons, mais aussi et peut-être surtout l’aliénation des ouvrières, leurs luttes, leurs revendications. Puis, il nous démontre dans la dernière partie la sauvagerie des marchés financiers, qui permettent, grâce à des pratiques très légales de s’enrichir furieusement sur le dos des hommes, des femmes, les rabaissant, les laissant sur le carreau, leur refusant presque la qualité et la dignité d’êtres humains. La démonstration de Simon Grangeat est imparable, parce qu’elle décrit la réalité, ce qui s’est vraiment passé : Jean-Charles Naouri reprend une entreprise qui ne vaut plus rien, baisse la masse salariale, procède à des licenciements en masse, et revend avec une énorme plus-value !
Yves Poey
De la cour au jardin
novembre 2017

L’histoire a débuté en 1932, comme un conte de fées, lorsqu’en revenant de son atelier, Jean Mantelet exaspéré par la purée pleine de grumeaux que lui servait sa femme, eut l’idée lumineuse d’inventer le moulin-légumes à manivelle. Vous en trouverez encore, c’est sûr, à la brocante et peut être aurez-vous un serrement au cœur en pensant à cet objet de grand-mère, qu’aujourd’hui Moulinex c’est fini, qu’il ne reste plus que le nom de la marque car tous toux ceux qui ont contribué à sa célébrité ont disparu, ont été renvoyés aux oubliettes. Qui ne se souvient de son moulin à café ou du bonheur simple d’avoir pu acquérir un robot Marie, une centrifugeuse… De la magie au quotidien, comment y résister, Boris Vian l’avait compris. Derrière les chiffres, derrière les objets que nous utilisons machinalement, il y a des femmes, des hommes, ne persistons pas à l’oublier. Cette belle page d’histoire qui commence comme un conte de fée et finit dans le bourbier, est racontée simplement par Simon Grangeat, sans didactisme.
Evelyne Trân
Le Monde
novembre 2017

Moulinex, c’est une épopée industrielle à la française, qui court du presse purée des années 30 au robot ménager. Une histoire longue de 70 ans qui traverse toutes les mutations économiques et managériales, du patron paternaliste aux délocalisations sans état d’âme.
Une pièce très documentée
Sur la scène du petit théâtre de l’Opprimé, quatre comédiennes et deux acteurs endossent tour à tour les bleus de travail des ouvrières, les blouses grises des contremaîtres d’avant-guerre puis les costumes cravates des « managers » des années 90. Avec beaucoup de finesse et de drôlerie, ils restituent sans temps mort une histoire industrielle bien de chez nous, avec son patron paternaliste, Jean Mantelet, ses « petites », les ouvrières en quête d’émancipation dans la France de l’après-guerre, son expansion fabuleuse avant la chute. Très documentée, la pièce mise en scène par Claude Viala ne tourne jamais à l’exposé didactique. On traverse allégrement 70 ans d’histoire industrielle et même d’histoire de France, avec l’évolution des styles, de la mode, des musiques, du ragtime au disco… Une histoire intime défile sous nos yeux, non sans émotion. Moulinex « libère la femme », et les publicités naïves de l’époque jouées sur scène font mouche, transportant le spectateur dans une France de « ménagères » et de « Géo Trouvetout ». C’est la France des trente glorieuses, de l’équipement des ménages, de l’euphorie de la consommation.
70 ans défilent, du presse-purée aux financiers
Tout commence par un presse-purée, conçu par Jean Mantelet en 1932. On débute à 14 ans à « Moulin-légume », et c’est plutôt mal vu pour une jeune fille d’embaucher à l’usine, dans cette Normandie berceau du groupe. La firme ne prend le nom de Moulinex que dans les années 60 avec l’irruption de l’électroménager. Les prix baissent, les cadences augmentent, le plastique et les syndicats font leur arrivée chez Moulinex. Le tableau se gâte à partir des années 90, quand le patriarche vieillissant (il meurt en 1991) est dépassé par la nouvelle donne économique. Les industriels ont cédé la main aux financiers, l’actionnaire réclame son dû. Le « downsizing », la délocalisation font rage pour écraser le coût du travail. Moulinex passera par plusieurs mains d’investisseurs controversés (Jean-Charles Naouri, le groupe italien Elettro Finanziara, dont les deux frères propriétaires sont croqués avec talent) avant d’être racheté par le concurrent de toujours, Seb. Une ère s’achève: celle des industriels, avalés par des financiers qui laissent derrière eux des usines fermées, des milliers de licenciements et empochent des parachutes dorés en passant. Sur l’autel dressé sur scène à la toute fin, une pyramide d’appareils Moulinex atteste d’une époque encore imprégnée de merveilleux, bien avant le règne de l’obsolescence programmée.
FranceInfo
novembre 2017


Le texte de Simon Grangeat, en plus d’être particulièrement bien documenté, expose avec clarté les dessous d’une entreprise, donnant au passage des notions d’économies et relatant plusieurs décennies de l’entreprise de Mantelet et la reprise de l’industrie par des financiers au mépris du personnel. Le texte qui n’occulte rien du drame humain (des cadences toujours plus rapides imposées aux ouvrières, des doigts coupés, des licenciements abusifs…) ne bascule jamais dans le pathos.
Nicolas Arnstam
froggydelight
octobre 2017

Un cœur Moulinex fait partie de ces spectacles documentaires réussis. Documentaire, car il s’agit de narrer au spectateur une saga industrielle qui a duré 69 ans, période par période. Réussi, car les comédiens font revivre devant le public tout un monde avec ses mentalités (tant du côté patronal qu’ouvrier) et ses évolutions. On est séduit par la simplicité avec laquelle chaque protagoniste exprime ses convictions, volontés, souffrances, désirs, entêtements parfois… C’est simple : on a l’impression qu’ouvrières, patron et contremaîtres viennent de débarquer dans le théâtre ! Les luttes d’influence sont rendues visibles. Le spectateur a le sentiment de partager la vie quotidienne des uns et des autres. Le texte passe régulièrement du dialogue au récit, voire au commentaire ou à l’analyse. La musique et totalement en phase avec le jeu. Le fait d’avoir scindé cette épopée en cinq périodes bien identifiables permet de suivre le fil d’une histoire qui a vu passer bien des acteurs, surtout vers la fin… Au lieu d’apitoyer le public ou de lui faire subir un discours engagé, les comédiens nous font rire devant les petits et grands défauts de chacun ou avec des anecdotes (les différents robots on porté les noms des secrétaires du patron, mais aucun n’a celui de son épouse, par exemple). La galerie de portraits qui est présentée est de ce fait assez variée, entre le patron qui ne veut pas licencier, mais qui ne veut pas entendre parler de Seb, les ouvrières qui arrivent directement de leurs fermes à l’usine et ne comprennent pas pourquoi les plus polyvalentes d’entre elles sont recherchées ou les cadres qui assurent ces dernières de leur sympathie tout en exigeant un accroissement permanent des cadences. Cette pièce touche par son humanité profonde.
Pierre François
Holybuzz
octobre 2017

Simon Grangeat conte cette aventure à la française, à travers ses protagonistes : le fondateur et sa femme, les ouvrières de l’usine, le dessinateur industriel, et les financiers. L’auteur décrit les mécanismes économiques en jeu et montre, à travers les personnages, les ressorts du capitalisme familial paternaliste, protégé par les barrières douanières, l’ouverture des marchés et une violente concurrence : « Toujours vendre à meilleur prix, déclarait Georges Pompidou en 1967, c’est la seule raison d’être du libéralisme. Nous serons donc en risque permanent. » On connaît la suite : délocalisations, mondialisation, avènement d’un capitalisme financier prédateur… Très documenté, le texte n’a pourtant rien de didactique et Simon Grangeat s’amuse avec cette histoire, en multipliant les points de vue, les adresses au public et les intermèdes ludiques.
Mireille Davidovici
Théâtre du Blog
octobre 2017