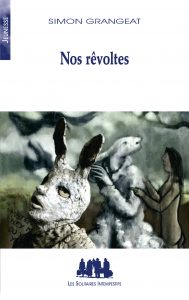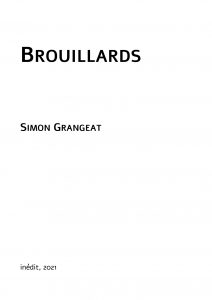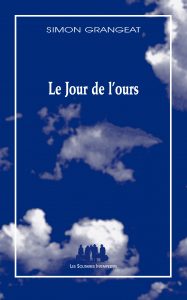Garçon
Les Solitaires intempestifs, 2025
104 pages
PERSONNAGES :
3 femmes
2 hommes
la pièce peut être prise en charge par deux interprètes
Prix et sélections
coup de cœur de La Revue des livres pour enfants, 2025
Soutiens à l’écriture
commande de la compagnie La Paloma, Thomas Fourneau, 2024
bourse de résidence d’auteur à l’école, CNL, 2024
écrite en résidence territoriale au collège Roger Ruel (43), portée par le Centre Culturel de La Ricamarie (42), 2023
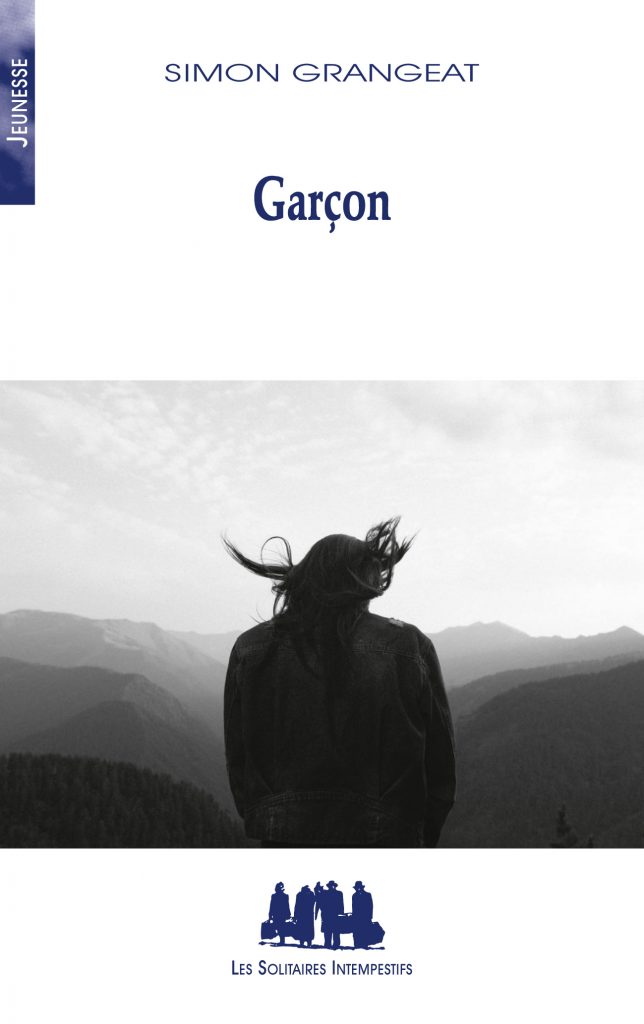
Un homme se tient face à une enquêtrice. Son fils a disparu. Sa sœur également, à qui il l’avait confié quelques mois plus tôt. L’homme parle peu. Il se trouve beaucoup d’excuses. N’est responsable de rien. Surtout pas de l’état du jeune homme. En parallèle à cet échange, à rebours, on découvre les derniers mois de la vie du jeune homme. Son arrivée à la campagne, placé là par un père qui ne gère plus ses responsabilités familiales. Ses premiers pas dans un nouveau collège. La découverte d’une vie si différente de la sienne. Les motos. Les longs week-ends dehors. La chasse. Le travail aussi, à portée de main, ici. Les bandes et la solitude mêlées.
Garçon interroge la manière dont on se construit garçon au milieu des autres. Comment se déjouent les filiations quand les liens sont abîmés ? Comment se construit le rapport à l’Autre ? La confiance. La parole. La prise de conscience de sa propre intériorité. La pièce dessine les chemins chaotiques d’une masculinité qui se cherche, entre attendus virilistes, prises de risques et détournements de genre.

mise en scène Thomas Fourneau
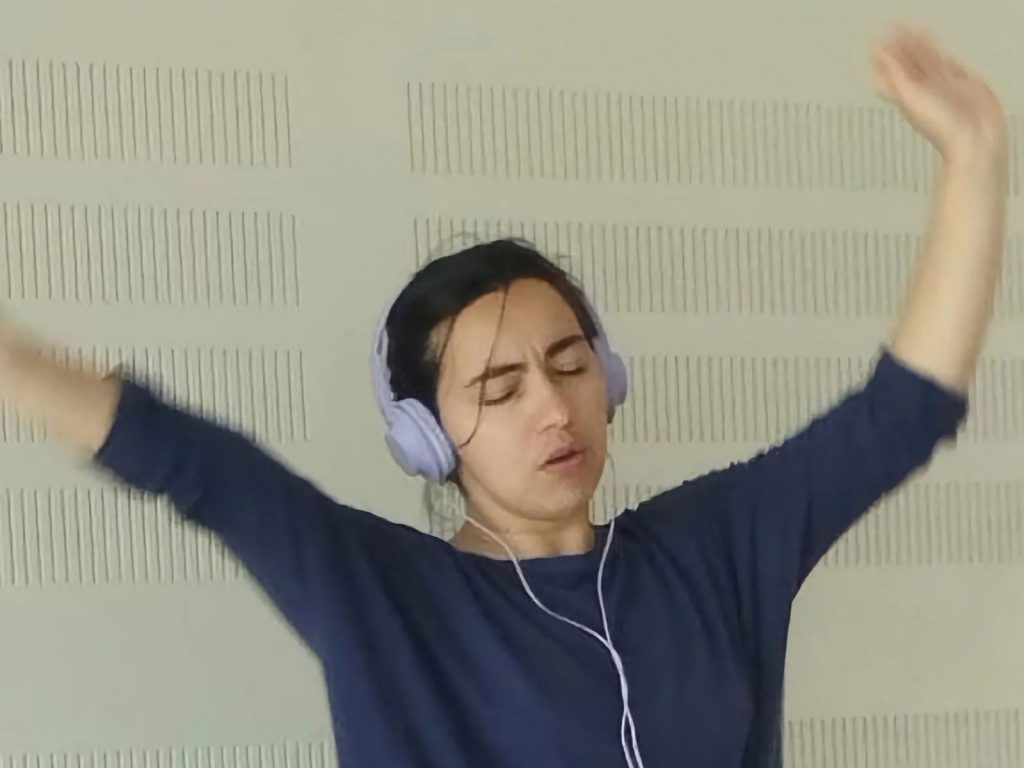
mise en scène Thomas Fourneau

mise en scène Thomas Fourneau
extrait
Camille. – Tu veux une clope ?
Garçon. – Je ne fume pas. Pourquoi je te mentirais ?
Camille. – Moi, j’ai commencé en cinquième. À l’époque, c’était moins cher. C’était plus courant aussi. Il n’y avait pas toutes ces campagnes de prévention.
(Elle se sert une bière.)
Tu en veux une ? Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça ? Ton père ne t’a jamais laissé goûter ? Les parents font des enfants qu’ils refusent de voir grandir. J’ai acheté des blondes. Elles ne sont pas très fortes. Tu peux me faire confiance. Tu n’as jamais bu d’alcool ? Il faut toujours une première fois. Qu’est-ce qui t’est arrivé aujourd’hui ? Raconte-moi.
Garçon. – Rien. Le collège, c’est tout.
Camille. – Ton œil est violet. Tu as du sang sur les lèvres.
Garçon. – Ils n’ont pas fait exprès. Ils ne voulaient pas me faire mal.
Camille. – Je suis une femme de parole, garçon. J’ai promis à ton père de m’occuper de toi. Il va falloir que tu y mettes un peu de bonne volonté si tu veux que les choses se passent bien.
(Garçon se sert une bière.)
Qui t’a fait ça ?
Garçon. – Qu’est-ce que ça changera si je te donne leurs noms ? Tu vas aller au collège demain ? Tu vas aller casser la gueule à des gamins pour leur montrer que tu es la plus forte ?
Camille. – Tu dois apprendre à te défendre.
l’écriture
Pour sortir des carcans et des prisons conservatrices, patriarcales, les auteurs et les autrices parlent depuis des décennies de l’émancipation féminine. Pour ce qui est des garçons, on n’entend parler – au mieux – que d’une déconstruction. Je n’arrive pas à voir dans cet idéal « déconstructionniste » autre chose que les pièces éparses d’un mécano ou d’un lego, abandonné sur le tapis. Difficile de m’en saisir. Difficile d’en faire une ligne d’horizon joyeuse.
Au départ de l’écriture de Garçon, il y a donc la nécessité intérieure d’interroger la possibilité d’une émancipation pour les garçons. Il y a cette intuition que quelque chose devrait pouvoir se partager de l’expérience d’une autre masculinité.
Cela interroge les processus de filiation, l’intergénérationnel et les assignations silencieuses. Le rapport à la parole, aux non-dits, aux coups encaissés solitaires. Cela interroge notre capacité à s’écouter, à s’accepter, à laisser surgir une émotion. L’individu pris dans sa cellule familiale, l’individu au sein de ses pairs, l’individu dans sa relation aux autres. D’autres histoires. D’autres héros.
En écrivant, j’avais sur mon bureau la photo de mon grand-père, ouvrier né en 1905 qui dut attendre ses 90 ans et un AVC qui faillit lui coûter la vie pour me prendre la main avec tendresse et me dire qu’il m’aimait. Je pense à son regard pour une fois apaisé.
Dans la presse

Louis, accaparé par son métier de médecin, confie son fils à sa sœur qui vit dans un village. Un matin, la gendarmerie l’informe que l’adolescent a fugué. Malgré la bienveillance et l’investissement de sa tante qui pallie, tant bien que mal, l’impuissance paternelle face à la dérive du garçon, ce dernier reste introuvable. À travers cette disparition, Simon Grangeat montre la fragilité des liens familiaux et la difficulté de communiquer avec son propre enfant quand tout semble se défaire. Une pièce psychologique intense où, comme souvent dans le théâtre jeunesse, la défaillance des adultes est pointée du doigt. Un texte qui permet d’ouvrir le débat notamment sur le sentiment d’abandon.
Fanny Carel
La Revue des livres pour enfants
septembre 2025
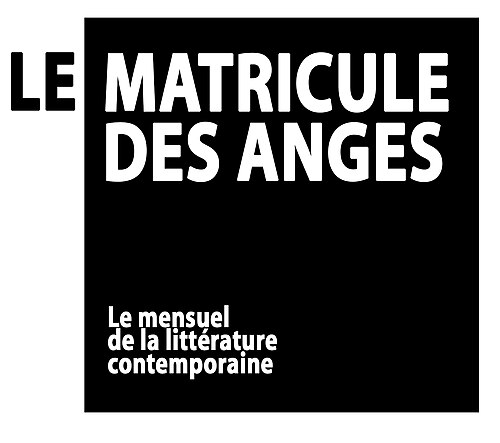
UNE AUTRE MASCULINITE
Simon Grangeat questionne la difficulté de se construire Garçon aujourd’hui.
Dans une note d’intention, Simon Grangeat raconte : « Pour sortir des carcans et des prisons conservatrices, patriarcales, les auteurs et les autrices parlent depuis des décennies de l’émancipation féminine. Pour ce qui est des garçons, on ne parle – au mieux – que de déconstruction. Je n’arrive pas à voir dans cet idéal “déconstructionniste” autre chose que les pièces éparses d’un mécano ou d’un lego, abandonné sur le tapis. (…) Au départ de l’écriture de Garçon, il y a la nécessité intérieure d’interroger la possibilité d’une émancipation pour les garçons. D’un devenir enviable. Il y a cette intuition que quelque chose doit pouvoir se partager de l’expérience d’une autre masculinité. »
Joli projet qui résonne ô combien dans notre monde qui met au pouvoir des hommes dits « forts », prônant la violence et le rapport de force comme solution à tous les problèmes.
Comme le titre de la pièce l’indique, le personnage principal se nomme donc Garçon, un jeune homme qui a « dévissé depuis plusieurs années » selon son père, Louis. Ce dernier s’occupait seul de son fils, sa femme étant décédée. Malgré tout, il continue de faire passer son travail de médecin en premier. Il est donc très peu présent pour son fils. Complètement dépassé, il décide de le confier à sa sœur, pour qu’elle prenne le relais. La tante Camille, qui n’a pas d’enfant, accueille donc Garçon sous son toit. Pour Garçon c’est une punition supplémentaire : se retrouver à la campagne alors que c’est un citadin et perdre tous ses amis. Il redouble alors de violences. Et cependant la rencontre avec sa tante et une jeune fille de sa classe, Aya, vont lui permettre d’accueillir de nouvelles émotions. Les deux femmes se confrontent aux provocations de Garçon, symbolisées par ses ongles qu’il refuse de couper, avec lesquels il griffe tous ceux qui l’approchent de trop près.
La pièce est construite comme une enquête de gendarmerie. Elle démarre avec la déposition du père expliquant que son fils et sa tante ne donnent plus de nouvelles depuis dix jours maintenant et qu’il ne sait pas où ils se trouvent. Le père cherche surtout à se disculper de son abandon de toute obligation familiale et enchaîne les lieux communs pour minimiser le mal-être de son fils. Pour lui : « Les garçons, ça se chamaille. C’est ce qu’on dit, non ? Si on devait s’inquiéter à la moindre bagarre… » Les séquences de déposition à la gendarmerie sont entrecoupées de flash-back qui retracent l’année passée de l’adolescent. Des séquences courtes comme autant de points de vue éclatés pour donner à voir les multiples facettes du chaos dans lequel se débat Garçon. Comment pour devenir un homme, un vrai, il lui faut assumer les clichés de la virilité, reproduire une forme de violence et surtout taire tous les sentiments un peu intimes. Mais c’est justement en accueillant une forme de vulnérabilité que Garçon va pouvoir déposer ses « griffes ».
La pièce n’est absolument pas moraliste, elle essaie juste de décrire la difficulté de se construire homme, en ce sens sa lecture est précieuse pour tous les jeunes en devenir.
Laurence Cazaux
Le Matricule des Anges
septembre 2025